

Histoire
Baziège, haut lieu du catharisme en Lauragais 13ème siècle
L’article sur Baziège est dédié à deux personnages historiques auxquels je suis passionnément attaché ; d’une part Aliénor, duchesse d’Aquitaine, reine de France puis d’Angleterre, reine des troubadours ; d’autre part, à Raimon de Miraval, "mon" troubadour toulousain, qui a certainement traversé Baziège de nombreuses fois. La poésie des troubadours flottera ainsi sur ces lignes consacrées par ailleurs à de cruelles batailles, à l’Inquisition et à l’acte de décès du comté de Toulouse (1229).
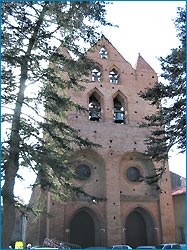
Eglise du pastel 14 / 15eme siècle
clocher mur pignon avec 2 tourelles, 5 baies
campanaires, façade ouest
La
richesse historique de Baziège
Le bourg de Baziège (3000 habitants) a une richesse d’évènements
historiques sans égal due aux recherches des historiens qui, depuis
9 ans, étudient les péripéties des baziégeois
à travers les manifestations des Médiévales. Sous le
nom de Badera, la cité gallo-romaine apparaît sur une carte (la
Table de Peutinger) du 4ème siècle après J.C ; traversée
par la prestigieuse voie romaine (via aquitania) construite par les Romains
vers 118 avant J.C, les armées qui allaient de Toulouse à Carcassonne
ont emprunté la "Grand Rue" ; la liste est interminable depuis
les Francs, les Wisigoths, les Arabes (en 720), les cavaliers des comtes de
Toulouse Raimon VI et VII, ceux de Pierre II d’Aragon, les Croisés
envahisseurs de Simon de Montfort. Nous avons choisi trois épisodes
de cette longue et passionnante histoire.

Borne militaire gallo-romaine venant
de la voie romaine d'Aquitaine
La
victoire de Baziège - 1219
Nous insistons lourdement sur le terme "victoire" car c’est
un des rares épisodes guerriers où les armées du comte
Raimon VII et du comte de Foix sont vainqueurs (1) des Croisés, qui,
eux, sont écrasés et massacrés. La Chanson de la Croisade
albigeoise lui consacre 243 vers alexandrins. La bataille s’est déroulée
sur les bords de l’Hers vieux, sur un espace découvert où
s’affronteront des masses de cavaliers, du côté du lieu
dit "les boulbènes", au Sud du village. Un très ancien
cadastre d’Ayguesvives de 1489 localise des parcelles de terres labourables
et des vignes donc un espace découvert. La date : hiver de 1219, c’est
à dire après la mort de Simon de Montfort devant Toulouse en
juin 1218 ; la période de la Reconquête occitane commence et
les Croisés seront progressivement refoulés hors de l’Occitanie
; vaincu, Amaury de Montfort (fils de Simon) quitte Carcassonne et regagne
la France en 1224.
Les historiens discutent sur les causes de la bataille. 3 thèses sont
en présence : une razzia par les Croisés venus de Carcassonne
et pillant le Lauragais (blé et moutons) ; ou une expédition
de pillage par le comte de Foix, en Lauragais ; ou enfin une ouverture planifiée
d’un second front par le comte de Foix ; Amaury était occupé
par le siège de Marmande.
Tableau
des forces en présence
Les occitans :
- l’armée du comte jeune
(Raimon 7)
- les chevaliers Unaud de Lanta
- l’armée du comte de Foix
(Raimon Roger)
- l’armée du comte de Comminges
- les faydits du Carcassès
- la milice toulousaine
- les routiers navarrais
Les
Croisés :
- chefs Croisés, vétérans de la Croisade : Foucaud de
Berzy, bourreau du Lauragais et Alain de Roucy
- des seigneurs occitans traîtres : Jean de Lomagne, Sicard de Lautrec,
Sicard de Montaut.
Une
bataille originale
Les Occitans sont très supérieurs en nombre, aussi les Croisés
sont dans l’obligation d’adopter une attitude défensive
en s’abritant derrière l’Hers, des chariots, des abattis
d’arbres. Dans une première phase, l’attaque occitane utilise
la cavalerie légère des "percussores" ou frappeurs
; ces cavaliers sont très rapides et armés de javelots, javelines,
frondes, arbalètes. Les résultats de cette attaque nous sont
donnés par le chroniqueur Guillaume de Puylaurens : "au début
de l’engagement, chargés de fer et encerclés par les piqueurs
et les arbalétriers montés sur des chevaux légers, les
Croisés souffrirent beaucoup de leurs coups". La deuxième
phase est l’attaque de la cavalerie lourde occitane conduite par le
futur Raimon VII et mêlée générale : les Croisés
sont écrasés. Le troisième épidode est l’intervention
des piétons, milice toulousaine et routiers (mercenaires) qui pillent
et massacrent les prisonniers ; quelques chefs croisés s’enfuient.
La victoire de Baziège marque le début de la reconquête
par les Occitans des terres prises par les Croisés.

Voie romaine
entre Baziège et Montgiscard
"les Pountils" au-dessus desquels
passaient la voie romaine
La
population de Baziège devant l’inquisition
Le catharisme s’est puissamment développé en Lauragais
; dans ce "coeur de l’Occitanie cathare", les évêchés
hérétiques sont nés à Saint Félix en 1167.
La Croisade s’est abattue sur nos malheureuses collines avec son cortège
de massacres, de bûchers (Lavaur, les Cassès, Labécède),
de batailles comme celle de Baziège en 1219. En 1233, l’Inquisition
est créée pour rechercher et condamner les suspects de catharisme
et les chevaliers lauragais devenus faydits (exilés et proscrits) se
sont réfugiés à Montségur.
L’enquête
de 1245
En mai 1242 les faydits descendent de Montségur et massacrent un tribunal
d’Inquisition à Avignonet (28-29 mai 1242) ; après la
chute du château, l’Inquisition enquête pour essayer de
connaître les coupables qui ont participé au massacre. Les archives
ont conservé les procès-verbaux des interrogatoires de toute
la population lauragaise soit 5500 déposants ; c’est avec ce
célèbre manuscrit 609 que l’on connaît très
bien les cathares lauragais et notamment ceux de Baziège. Pour notre
village, il y a 138 dépositions, 299 à Montesquieu, 222 à
Avignonet, 93 à Montgiscard, 81 à Fourquevaux, 64 à Renneville
; l’enquête la plus fructueuse eut lieu au Mas Saintes Puelles
où l’on compte 401 déposants.
Les habitants de Baziège avaient déjà été
invités à déposer devant les Inquisiteurs assassinés,
en 1241 ; ensuite en 1242 le dominicain Guilhaume Pélisson, avec un
confrère, était venu à Baziège recueillir l’abjuration
d’un jeune Parfait converti, de Saint André de Landelle (alors
une paroisse proche des Varennes), donc les Inquisiteurs se sont fortement
intéressés aux Baziègeois.
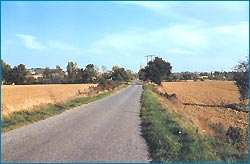
Voie romaine entre Baziège et Montgiscard
Les
seigneurs de Baziège sont tous cathares, parfaits et croyants
Il y avait avant la Croisade un Baziège (c’est son nom) de prénom
inconnu, marié à une Saura devenue Parfaite chez elle, comme
une Ava, autre dame du lieu, veuve d’un Pierre de Baziège. En
Baziège et Saura (Parfaite) avaient deux enfants, Pierre de Baziège
et Arnaud ; Pierre épouse Ava (Parfaite) ; de ce mariage naît
Pierre de Gardouch (Croyant cathare) qui épouse Mateude (Croyante)
; enfin un autre Pierre de Gardouch est "consolé" (il reçoit
le baptême cathare ou consolament). Arnaud de Baziège "consolé"
épouse Austorgue qui est "emmurée" (emprisonnée)
pour un temps indéterminé le 26 mars 1246 ; Arnaud lui même
est "consolé" à sa mort par deux diacres cathares
à Avignonet en 1238. Bertrand de Baziège est Croyant ; il épouse
Condor Maurand, Croyante et issue de la grande famille cathare des Maurand.
Cette alliance montre la grande puissance et richesse des seigneurs de Baziège.
Il y avait encore un chevalier,Guillaume de Baziège, à Avignonet,
tout aussi Croyant que les autres.
Un
déposant
La plupart des déposants n’ont rien vu ou fait, ou peu de chose
; cependant Pierre Mir dit qu’il a vu trois Parfaits à Toulouse
dans la maison de Baziège, près de la boucherie et vit là
avec eux, Baziège (c’est le nom d’un chevalier), seigneur
de Baziège, sa femme Austorgue et Faure de Bagan, mais il n’a
pas adoré ni vu adorer (salutation rituelle des cathares) ; il dit
cependant qu’il a donné à manger une fois à Alleman
de Rouaix, condamné. Les autres déposants disent généralement
qu’ils "n’ont pas vu de Parfaits".
Les
noms de famille perdurent jusqu’en 2003
Une autre remarque intéressante concerne les noms de famille baziégeois
des déposants, on relève beaucoup de noms toujours portés
en 2003 par des personnes habitants toujours Baziège ou des villages
lauragais; nous avons choisi : Estieu, Jourda, Bernard, Mir, Galtier, Bascoul,
Garcias, Imbert, Gros, Rouaix, Lamothe, Huc, Amiel, Bonafous, Gélis,
Fournier, Marty, Maury, Sans, Espitalier. Tout cela traduit une remarquable
stabilité des noms de famille depuis 800 ans.
Le
traité de Paris (1229) est préparé à Baziège
C’est à Baziège que sont signés les préliminaires
du traité de Paris en 1229. Ce traité est l’acte de décès
du comté de Toulouse ; l’immense et puissant comté, d’Agen
au Rhône, l’orgueilleuse et brillante dynastie des Raimon (Raimon
IV,V,VI VII) disparaît de l’histoire au profit du roi ; c’est
à Baziège que ce drame débute.
Après le départ d’Amaury de Montfort en 1224, le roi de
France est l’héritier de tous ses droits sur le comté
de Toulouse ; pour le conquérir le roi Louis VIII déclenche
la victorieuse Croisade royale en 1226. En 1228 Raimon VII est vaincu et prêt
à accepter les conditions imposées par l’Eglise et le
roi surtout lorsque Humbert de Beaujeu ravage systématiquement le territoire
autour de la ville de Toulouse, arrachant vignes et arbres fruitiers, saccageant
moissons et potagers ; une véritable catastrophe s’abattit sur
la cité comtale. L’armée du roi fait alors des offres
de paix ; en septembre, le légat du pape auprès de la reine
Blanche de Castille, le cardinal de Saint Ange, fait des propositions par
l’intermédiaire de Garin, abbé de Grand Selve, abbaye
puissante de l’Ordre de Citeaux, située sur la commune de Bouillac,
près de Verdun sur Garonne, à l’Ouest de Montauban. Roquebert
écrit : "une rencontre préliminaire eut lieu près
de Baziège ; le comte accepta ce qui lui fut demandé, à
titre préliminaire il doit combattre l’hérésie,
se reconnaître vassal du roi de France, mais le comté était
sauvé". Pour quelques années seulement.

Baie géminée style roman façade nord
du clocher
Par
le traité de Paris, le comté disparaît
Après avoir signé l’accord de principe à Baziège,
Raimon VII est convoqué à Paris au printemps 1229 et doit accepter
les conditions très dures du traité de Paris. Le comte devait
payer des dommages de guerre exorbitants, détruire une trentaine de
ses forteresses, accepter la création d’une Université
à Toulouse ; sa fille unique, Jeanne, doit épouser un frère
du roi, Alphonse de Poitiers et, à leur disparition, le comté
tombera dans les mains du roi, ce qui arrivera en 1271.
A Baziège c’est la disparition du comté de Toulouse qui
est préparée.
Couleur Lauragais vous a présenté trois épisodes de la
si riche histoire de Baziège ; dans le prochain numéro, nous
vous ferons découvrir des villages inconnus, des pigeonniers, des ponts
sur le canal du Midi, vers Montgiscard et Pompertuzat, ou le monument aux
morts de Pouze.
Jean
ODOL
Bibliographie :
Michel Roquebert :"Cathares,
la terre et les hommes" 2002
Jean Odol : "Catharisme en Lauragais et bataille de
Baziège 1219"
Guillaume de Tudèle : "La Chanson de la Croisade albigeoise",
3 tomes
Crédit photos : Jean ODOL.
Couleur Lauragais N°52 - Mai 2003