

A la découverte de la Gastronomie du Lauragais
La gastronomie traditionnelle du Lauragais est d'une richesse infinie et d'une excellente qualité, tant la gastronomie des tables paysannes que celle que l'on découvre dans d'illustres restaurants contemporains. Mais, sauf le cassoulet, elle est peu connue car la publicité et l'information culinaire sont souvent insuffisantes. Couleur Lauragais vous fait découvrir la gastronomie traditionnelle, puis nous tracerons plusieurs pistes pour vous conduire vers quelques bonnes adresses.

Les
bases de la Gastronomie traditionnelle
La gastronomie du Lauragais repose sur les productions locales, végétales
et animales. Le blé dur donne des farines de très haute qualité
pour le pain ; l'appellation "blé du Lauragais" perdure de
nos jours car il demeure très recherché ; au Moyen Age, le blé
était la plante courante donnant le pain blanc (ou pain de couvent)
alors qu'ailleurs régnait le seigle et l'épeautre.
Le pain de maïs est de retour
Le maïs américain apparaît dans notre histoire par une note
sur le journal de bord de Christophe Colomb en novembre 1492 lors du premier
voyage de découvreur du Nouveau Monde sous la forme "maïse".
Il s'agit d'une plante miracle pour le Lauragais ; il est coté pour
la première fois sur le marché de Castelnau-dary vers 1640 ;
il est certainement arrivé du Portugal et du Nord de l'Espagne par
la côte basque puis Bayonne, la Gascogne, Toulouse, Castelnaudary. Tout
est consommé dans le maïs : le cime fournit un fourrage vert aux
bovins vers le 15 août, puis desséché c'est le complément
en automne et hiver, le "charbon blanc" ; les racines mêmes
sont brûlées au feu de la grande pièce commune des bordes
lauragaises. La farine est très blanche et très fine car tirée
de grains très petits et d'un épi (la millette) de 10 cm de
long ; elle est à la base du pain de maïs qui fait disparaître
très tôt les famines (seconde moitié du XVIIIème
siècle).
 Le
millas, une bouillie de farine et d'eau salée, est la base de l'alimentation
des paysans pauvres jusqu'en 1900 ; dans un grand chaudron de cuivre (le païrol)
on jette lentement la pluie de farine dans une eau frémissante en remuant
avec un gros bâton ; la bouillie obtenue est vidée ensuite sur
une table que l'on incline dans tous les sens pour obtenir une immense galette
d'épaisseur uniforme (2-3 cm environ). Le millas remplace le pain de
froment ; il peut être transformé en dessert, doré à
la poêle, avec du sucre. J'ai bien connu la préparation de ces
mets dans la cuisine de ma grand mère. Le mesturet est un millas avec
de la pulpe de citrouille rouge, puis du sucre, des œufs, des zestes
d'orange et de citron, du rhum, du beurre.
Le
millas, une bouillie de farine et d'eau salée, est la base de l'alimentation
des paysans pauvres jusqu'en 1900 ; dans un grand chaudron de cuivre (le païrol)
on jette lentement la pluie de farine dans une eau frémissante en remuant
avec un gros bâton ; la bouillie obtenue est vidée ensuite sur
une table que l'on incline dans tous les sens pour obtenir une immense galette
d'épaisseur uniforme (2-3 cm environ). Le millas remplace le pain de
froment ; il peut être transformé en dessert, doré à
la poêle, avec du sucre. J'ai bien connu la préparation de ces
mets dans la cuisine de ma grand mère. Le mesturet est un millas avec
de la pulpe de citrouille rouge, puis du sucre, des œufs, des zestes
d'orange et de citron, du rhum, du beurre.
Le pain de maïs est de retour : dans le Lauragais, des boulangers nous
offrent du pain de maïs sous forme demi sphériques de diamètre
30cm et de 20 cml d’épaisseur au centre, issu d'un mélange
mystérieux de farine de blé et de maïs, avec des levures.
Le haricot est lui aussi d'origine américaine et ramené en Europe
par Christophe Colomb : c'est la troisième base végétale
de l'alimentation (avec les fèves) des lauragais ; il se répand
en Lauragais au milieu du XVIIème siècle. Il devient le support
incontournable du cassoulet.
Les viandes sont nombreuses et abondantes avec les bœufs de race gasconne
sacrifié à la fin de leur vie (10-12 ans) après engraissement
aux fèves-maïs et complété parfois avec du miel.
Les moutons et agneaux sont d'une race spécifique : la race lauragaise
; grands, sans cornes, avec une très forte ossature, donnant peu de
lait, peu de laine, ils sont très rustiques. Les volailles sont très
nombreuses dans chaque borde ; les poules sont noires, ressemblant à
la race de Caussade ; l'oie de Toulouse recouvre tout le Lauragais ; les canards
mulards donnent des foies d'une finesse exceptionnelle. Les porcs sont 2-3
dans chaque exploitation et engraissés avec des fèves et du
maïs.
Les foires aux bovins et moutons ont toutes disparu ; le marché aux
veaux de Puylaurens a connu un temps de célébrité internationale
avec des exportations massives vers l'Italie. Les marchés aux volailles
"naturelles" élevées en plein air, comme dans le passé,
perdurent à Revel (le samedi), Belpech, Castelnaudary, Ville-franche,
Puylaurens, Caraman, Auterive, Baziège. Un trait récent est
la création de nouveaux marchés dans quelques bourgades comme
Castanet, St-Orens, Montgiscard, Escalquens, Avignonet (la nuit).
Découvrons la Gastronomie lauragaise
Un vieux livre de recettes me sert de sources d'informations culinaires ;
des centaines sont toutes consacrées au Pays de Cocagne, avec des mets
simples mais somptueux, qu'avec amour nos ménines mitonnaient dans
leurs païrols ou leurs toupines. Leur variété est immense
et nous laissons de côté, provisoirement, bien des recettes que
Couleur Lauragais reprendra dans d'autres numéros.
Les soupes
D'abord les soupes qui étaient la base de l'alimentation des paysans
pauvres jusqu'en 1900 environ ; nous citerons la soupe à l'ail rose
de Lautrec, la soupe à la citrouille, la soupe au boudin du jour où
on tue le cochon (ou "festo pourcalo"), la soupe de fèves.
Je laisse en attente la poule au pot de cocagne qui, curieusement, figure
avec les soupes.
Les entrées et viandes
Il faut déguster le jambon de Lacaune au beurre de cocagne, les févettes
du cathare, le foie de canard confit, le melsat (ou boudin blanc), la saucisse
à l'ail, la sanguette, les sept omelettes.
Pour les poissons, nous retiendrons la brandade tarnaise, bifteck de thon
à la poêle, des crevettes (gambas) à la braise, l'anguille
au vin de Fitou, des grenouilles sautées à l'ail confit, les
vairons et goujons frits du Sor.
Les viandes les plus connues sont l'agneau de Pâques, la blanquette
d'agneau, la côte de bœuf à la toulousaine, la daube de
mouton, la daube d'auroch (à Baziège et Avignonet), la joue
de veau de Puylaurens.
Les volailles et gibiers
Un choix parmi des dizaines de recettes ; vieux coq aux deux vins, lapin à
l'ail de Lautrec, canard musqué aux olives, pigeon au four, poulet
à la braise, coq à la bière, poulet à la pierre,
la pioto de Nadal (la dinde de Noël). Pour les gibiers ; la caille avec
ses œufs, côtellettes de sanglier, faisan farci au foie gras, lièvre
à la broche, perdreau aux lentilles, lapin sauvage à la moutarde.
Les légumes
On peut déguster des aubergines à la lauragaise, des asperges,
les petits pois du cathare à la sarriette, des culs d'artichauts, les
deux gratins de cocagne (au Roquefort et au fromage de table de Laguiole),
les tomates farcies.
Les plats de résistance
Citons l'alicuit d'oie, escargots au foie salé, le magret en gelée,
les lentilles au confit d'oie ; la padénado de cocagne est une sorte
de paëlla avec de la graisse de canard, du riz, du bouillon de volaille,
des cœurs d'oie confits, des gésiers d'oies, des morceaux de cous
d'oies, du safran.
Le divin cassoulet
 On
l'appelle aussi très simplement : les haricots de cocagne ; c'est le
plus connu de la gastronomie lauragaise ; c'est le dieu de la cuisine occitane,
avec la célèbre trilogie : Dieu le Père est le cassoulet
de Castelnaudary, Dieu le Fils celui de Carcassonne, le Saint Esprit celui
de Toulouse. Le grand centre est Castelnaudary, sans rival, mais chaque restaurant
ou auberge a pratiquement son cassoulet maison, avec de nombreuses variantes
ou présentations ; il faut au minimum la cassole en terre d'Issel et
des haricots, soit lingots, soit cocos ; La singularité, pour celui
de Castelnaudary, étant de le finir dans le four du boulanger chauffé
aux genêts épineux de la Montagne Noire et pendant la dernière
phase de la préparation on mélange à sept reprises aux
haricots la peau transparente qui se forme en surface.
On
l'appelle aussi très simplement : les haricots de cocagne ; c'est le
plus connu de la gastronomie lauragaise ; c'est le dieu de la cuisine occitane,
avec la célèbre trilogie : Dieu le Père est le cassoulet
de Castelnaudary, Dieu le Fils celui de Carcassonne, le Saint Esprit celui
de Toulouse. Le grand centre est Castelnaudary, sans rival, mais chaque restaurant
ou auberge a pratiquement son cassoulet maison, avec de nombreuses variantes
ou présentations ; il faut au minimum la cassole en terre d'Issel et
des haricots, soit lingots, soit cocos ; La singularité, pour celui
de Castelnaudary, étant de le finir dans le four du boulanger chauffé
aux genêts épineux de la Montagne Noire et pendant la dernière
phase de la préparation on mélange à sept reprises aux
haricots la peau transparente qui se forme en surface.
Les desserts
Ils sont très nombreux ; citons les oreillettes, la croustade des vendanges,
la fouace des rois, les méringues d'autrefois, mélange de fruits
occitan, le mesturet, la millasine, les crêpes (pescajous).
Fromagers et conserveurs
Le Lauragais ancien connaissait peu de fromagers ; récemment des élevages
de chèvres et de vaches fournissent d'excellents produits, à
peine connus et cependant, pour l'un d'entre eux (de Marquein) ses fromages,
type parmesan sont exportés en Allemagne. Les principaux fromagers
sont installés à Auzielle, Saint Félix, Marquein, la
Pomarède, Revel, Tréville, Labastide-Couloumat, Payra sur l'Hers,
Pech Luna, Gaja la Selve.
De très gros conserveurs sont surtout à Castelnaudary, où
certains ont un rayonnement international notamment pour le cassoulet, mais
également des ateliers importants sont à Salles sur l'Hers,
Villenouvelle, Saint Félix, Belpech, Bram, Montgiscard, Corronsac,
Revel, Villefranche, Montgaillard, Lanta.
Les bonnes adresses gastronomiques
Le Lauragais compte d'excellents restaurants. Castelnaudary est la capitale
du cassoulet et la conserverie mais dans tous le Lauragais on trouve d’excellents
restaurateurs et conserveurs. Sur la carte ci-jointe, nous avons localisé
les restaurants et auberges du Lauragais; que ceux qu auraient été
oubliés veuillent bien nous en excuser.
On peut distinguer 3 types de restaurants :
- les auberges
- les restaurants réservant une large place aux spécialités
lauragaises
- les restaurants que j'appelle "polyvalents", avec spécialités
régionales, spécialités maison, et menus "nouvelle
cuisine".
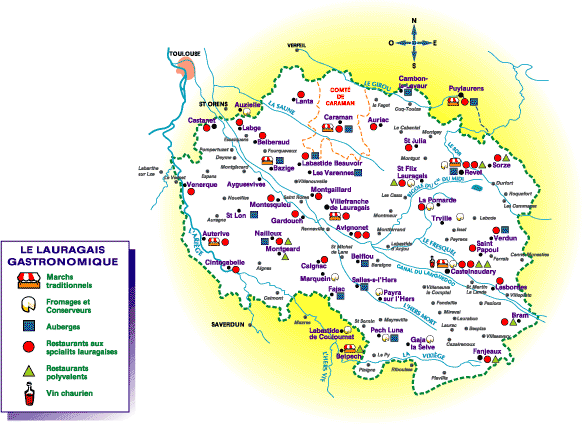
Les vins
Nous gardons les vins en conclusion. Le Lauragais produisait jusqu'en 1885
des vins abondants mais de bien piètre qualité, une véritable
piquette ; la crise du phylloxéra (1885-1890) a détruit totalement
ce vignoble qui a été ensuite partiellement reconstitué
avec des porte greffes américains ; la qualité restait médiocre
; il n'y a jamais eu de bons vins en Lauragais. A partir de 1960 les vignes
lauragaises disparaissent et aujourd'hui elles sont devenues une curiosité
; cependant depuis 2001 apparaît sur nos tables un vin chaurien, produit
par le lycée agricole de Castelnaudary : il présente de très
intéressantes promesses.
On assiste actuellement chez les gourmets et amateurs éclairés
de la gastronomie lauragaise à un retour aux sources avec une demande
grandissante de mets régionaux et spécialités locales.
Ami lecteur, Couleur Lauragais publie dans ses colonnes tous les mois des
annonces de restaurants, avec une carte ; aussi les lecteurs pourront y trouver
l'adresse précise des sorties gastronomiques dominicales.
Jean ODOL
Couleur Lauragais N°43 - juin 2002